Productisez ou périssez : ne pensons plus service, pensons produit (1/2)
Productisez ou périssez : ne pensons plus service, pensons produit (1/2)
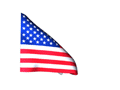
Analyse fondée sur des sessions fermées et sur invitation durant la San Francisco Tech Week 2025, dont une session privée où intervenait Aliisa Rosenthal (Head of Sales, OpenAI). Le tout est complété par une revue 2020–2025 (HBR, MIT Sloan, Wharton,Berkeley) et nos travaux transatlantiques issus de nos pitchs et IM.

Chronique d’un virage que le marché commence à pricer
San Francisco, la semaine dernière. Dans les couloirs bondés de SF Tech Week, on a vu un spectacle familier et pourtant nouveau : des fondateurs qui parlent “résultats”, des decks où l’on vend des“interfaces” plutôt que des “livrables”, des dirigeants de grands groupes qui murmurent qu’ils n’achètent plus des “jours-hommes” mais des “solutions vivantes”. Et, dans deux salons où a16z rassemblait opérateurs, investisseurs, CEO et CPO, la même intuition revenait : les services ne s’éteignent pas - ils changent de physique.
En tant que banque d’affaires transatlantique, nous avons un pied dans l’escalier mécanique des marchés européens et l’autre sur la rampe de lancement de la Sillicon Valley. Notre lecture est simple : la productisation des services n’est pas une mode, c’est une nouvelle grammaire économique. Elle transforme la manière de vendre, d’opérer… et d’être valorisé.
Concrètement, qu’est-ce que ça change ?
Imaginez votre offre de service dans un cockpit de logiciel. Tout à coup, on peut mesurer, tester, itérer.
Le coût d’acquisition par offre (CAC) n’est plus une ligne floue mais un levier pilotable ; la valeur vie client (LTV) devient un actif qu’on fait croître par l’extension (modules, options, sièges) plutôt que par des relances opportunistes.
Le pricing cesse d’être un barème à déterminer : on expérimente du tiering (bon/mieux/best), de l’usage-based, des SLA premium, on A/B-teste des packs - et on aligne le prix sur la valeur perçue plutôt que sur le temps passé.
Côté revenus, on parle ARR/MRR, NRR et expansion ; côté coûts, on vise une marge brute cible et on fait descendre le coût marginal grâce à l’IA et aux processus.
Résultat : la gestion quitte le bricolage au projet pour entrer dans la mécanique de la scalabilité.
Ainsi, vous vous rapprochez du business model des sociétés aux multiples de valorisation les plus élevés de monde : les logiciels… les SaaS.
En pratique, cela change tout pour un CEO de services : on passe d’une économie aléatoire (pipeline de missions, résultats heurtés) à une économie instrumentée (cohortes, rétention, payback CAC, time-to-value).
On voit ce qui crée de l’adhérence, on industrialise ce qui répète la valeur, on personnalise uniquement là où l’impact se joue.
Et - bonus qui intéresse les marchés - ce langage produit (récurrence lisible, rétention mesurable, IP tangible) réécrit votre narratif de valorisation.
Certains ont déjà entamé ce virage sans vraiment réaliser qu’ils sont sur le chemin de la productisation.
Alvora Partners vous présente un framework pour cadrer votre approche et mettre des mots et des concepts sur ces mutations.
Dans un premier temps, nous revenons sur la productisation pour comprendre le passage de temps × prix à résultat × répétabilité.
Dans un second temps, nous montrons comment l’IA (appuyée par cloud/data/no-code) rend ce basculement opérant : automatisation du bas de pyramide, codification du savoir, cockpit produit.
Enfin, nous détaillons les enjeux pour un dirigeant et la réaction des marchés, avant de traiter les objections clés, de proposer un playbook concret, puis d’exposer le timing et les implications de valorisation.
De l’artisanat de haut vol au produit assumé
Qu’appelle-t-on “productiser” un service ? C’est prendre une prestation ad hoc et en faire une offre définie, marquetée et tarifée - un “pack” que l’on comprend et que l’on peut répéter.
- Définie, parce que la valeur est formalisée, les étapes sont standardisées et souvent modulaires.
- Marquetée, parce qu’elle porte un nom, une promesse, une preuve d’impact.
- Tarifée, parce qu’on sait à l’avance ce qu’on achète, combien ça coûte, et à quelle cadence (très souvent récurrente).
Dit autrement : on passe d’une économie temps × prix à une économie résultat × répétabilité.
Dans une cuisine, c’est la différence entre le plat “hors carte, on va voir” et une carte maîtrisée : recettes testées, brigade rodée, expérience constante - avec toujours, pour les clients stratégiques, une table du chef où l’on peut ajouter une touche sur-mesure là où ça compte.
Pourquoi ce changement séduit-il le marché ? Parce qu’il retire de l’aléa et ajoute de la lisibilité : cycle de vente plus court (on comprend), satisfaction plus stable (on répète), coût marginal décroissant (on industrialise).
Et au bout de la chaîne, cela se voit dans les marges et dans les multiples.
Pourquoi cela ne s’est pas fait plus tôt ? Parlons IA
L’IA est invoquée à tout va, au prix de débats sans véritable valeur ajoutée pour un dirigeant.
Or ici, il faut reconnaître que les LLM et autres technologies émergentes accélèrent la productisation en offrant une couche technologique compétitive.
Notre grille de lecture autour du rôle de l’IA se résume à : déplacerl’humain, pas l’effacer.
En effet, on pourrait croire que l’IA “remplace”. Dans les faits, elle réorganise.
Le bas de la pyramide (recherche, synthèse, mise en forme, contrôles répétitifs) devient un pipeline automatisé.
Ce que vos équipes faisaient “comme elles pouvaient” devient un actif : prompts, playbooks, copilotes, jeux de données. Le savoir tacite se code.
Conséquence immédiate : l’expert remonte là où il crée le plus de valeur - cadrage, jugement, arbitrage, relation.
Et le service, délesté d’une partie de sa variabilité, se prête enfin à la répétition de qualité.
C’est le point de bascule où la récurrence devient naturelle, et où les logiques produit (essai, sandbox, “lite”) ouvrent des chemins de distribution plus rapides et moins chers.
Autour de l’IA, le cloud, les plateformes data et le no/low-code abaissent le coût d’industrialisation : un chef de pratique peut créer un mini-produit (dashboard, workflow, copilote métier) sans mobiliser une armée de développeurs.
Résultat : la productisation descend au niveau des équipes.
On parle soudain de micro-SaaS, de services“packagés”, d’offres à abonnement dans des métiers où l’on facturait hier au temps passé.

Où sont les enjeux pour un dirigeant et pourquoi les marchés réagissent
Premier enjeu : la clarté.
Un service productisé se raconte. Il porte un nom, une promesse, un avant/après mesurable.
Cela raccourcit la vente, facilite l’onboarding et réduit le risque perçu.
On n’achète plus “du travail”, on achète une capacité.
Deuxième enjeu : l’efficience.
La standardisation au bon niveau augmente la qualité (moins de variance, plus de QA) et fait chuter le coût marginal de délivrance.
C’est précisément là que le P&L s’améliore : davantage de coûts fixes (plateforme, data, maintien produit) amortis sur une base installée plus large, et moins de coûts variables qui montent avec chaque mission.
L’un des moteurs principaux de la productisation des services est la recherche de scalabilité - c’est-à-dire la capacité à décorréler la croissance du chiffre d’affaires de la croissance linéaire des effectifs.
Troisième enjeu : la différenciation.
Oui, la standardisation peut faire peur (“commoditisation”). Mais c’est une peur utile : elle oblige à créer de vrais moats - des données propriétaires, une expérience client vivante (un cockpit, pas un PDF), un branding d’offre qui compte.
On cesse de “faire de tout pour tout le monde” pour devenir opinionated : voilà ce que l’on fait, voilà comment, voilà la valeur.
Côté marchés, tout cela se lit dans des indicateurs que les investisseurs comprennent :
- part de revenus récurrents en hausse ;
- NRR (net revenue retention ) qui progresse;
- marge brute qui se rapproche des standards logiciel ;
- et, en M&A, un narratif IP crédible (plateforme, data, méthode).
Les actifs “produits + data + marque d’offre” tirent mécaniquement les multiples.
On le voit déjà dans les rapprochements : cabinets qui acquièrent des éditeurs de niche, éditeurs qui internalisent des équipes service pour garantir le résultat, et stratégies de build-up où plusieurs acteurs services s’agrègent sur une même plateforme.
Le filrouge : transformer du travail en actifs.
Pourtant, on nous dira :
« Nos clients veulent du sur-mesure. » Très bien : gardez-en là où l’impact se joue (10–20 % de l’offre), mais rendez reproductible tout ce qui ne crée pas d’alpha. C’est le socle de la qualité.
« On va perdre notre touche humaine. » Non, si l’on formalise le Human-in-the-Loop : à quels moments l’expert intervient, pourquoi, avec quelle valeur ajoutée. Ce n’est pas une concession, c’est un standard.
« L’investissement initial est lourd. » Oui : documenter, outiller, nommer, versionner - c’est un capexintellectuel. Le retour vient de la récurrence et de l’échelle. Financez-le comme vous financeriez un produit.
« Et le risque de prix ? » Il existe. On le contre par des données (benchmarks, historiques, modèles), par une UX qui rend la valeur visible au quotidien, et par une promesse claire (SLA, time-to-value, indicateurs suivis avec le client).

Concrètement, les playbooks qu’on observe
- Faites l’inventaire de votre IP. Méthodes, jeux de données, heuristiques, templates.
Ce qui est réutilisable doit être identifié et… réutilisé. - Choisissez le cas d’usage 10x. Récurrent, douloureux, mesurable. Donnez-lui un nom.
On n’achète pas des heures ; on achète “RiskWatch”, “DealDesk AI” ou “ClaimsPilot”. - Productisez. Périmètre, outputs, QA, SLA.
Livrez une interface (cockpit, alertes, benchmarks), pas un livrable statique. - Modularisez. Un core standard + quelques options différenciantes.
La personnalisation devient un choix clair, pas une dérive de projet. - Mettez l’IA au centre. Extraction, génération, classification, copilotes internes.
Documentez le moment humain (validation, arbitrage, explication). - Passez en récurrent.
Abonnement ou usage, pricing lisible, parcours PLG (essai, “lite”, sandbox). - Gouvernez en produit. Roadmap trimestrielle, versioning, métriques (NRR, marge brute, time-to-value).
On pilote une offre, pas une file de projets.
Test simple : si vous ne pouvez pas pitcher votre offre comme un produit en 30 secondes -nom, promesse, preuve- elle n’est pas prête.
Pourquoi le timing compte
À SF Tech Week, on a vu un consensus discret : les clients achètent désormais des résultats continus plus que des “missions ponctuelles”.
Ceux qui s’installent tôt posent les rails : ils verrouillent la relation par la donnée (ce que l’on mesure), par l’interface (ce que l’on voit) et par la fréquence (ce que l’on vit).
Pendant que d’autres négocient des TJM, ils construisent des bases installées.
Pour un comité d’investissement, cela change tout : trajectoire de mix récurrent, net revenue retention qui raconte une histoire, marge qui converge, M&A lisible (acquisition d’actifs, carve-out produit, build-up IA sur une verticale).
La fenêtre est ouverte pour offrir des equity stories 2.0 en les basant sur ce qui compte : répétabilité et actifs.
En guise de boussole
La productisation n’est pas l’ennemie du service ; c’est la forme moderne du service.
Elle rend tangible l’intelligence d’un métier, l’interface, la mesure et la répétition.
Elle permet de créer plus de valeur… et, surtout, de mieux la capturer.
Notre conviction : la prochaine décennie du tertiaire ressemblera davantage à du software : des offres nommées, des expériences continues, des revenus visibles.
Les dirigeants qui embrassent ce paradigme tôt ne vendront plus du temps : ils posséderont des actifs et pourront décorréler la croissance du chiffre d’affaires de celle des effectifs, mais aussi décorréler la valeur de leur actif de leur propre valeur en tant que dirigeants.
Dans notre prochaine série, nous vous présenterons des cas concrets de productisation en cours - fini la théorie.
La team Alvora Partners
Ship the deal, not the deck
Banques d’affaires NextGen